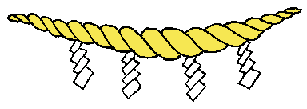Au Japon,
il y a deux fois plus de croyants que d'habitants, chaque individu pouvant
s'adonner à plusieurs religions en même temps. En effet, et selon une boutade
bien connue:
1)
LA RELIGION SHINTOÏSTE
"Le Japonais nait
Shinto, raisonne Confucianiste ou Zen, et meurt Bouddhiste".
Dans ce contexte,
vouloir recenser les pratiquants relève de la gageure; disons que la moitié
de la population de l'archipel nippon est Shinto,
que 40% sont bouddhistes, le reste se
répartissant selon les sectes les plus représentatives. Les chrétiens
se situent aux environs de 1% (soit quand même près de 1,5 million d'habitants).
Mais que prêchent-elles ? C'est ce que nous allons nous employer à vous montrer.
Prêtres shinto en tenue de cérémonie avec
leur coiffe de gaze.
Qu'est-ce
que c'est ?
Corde tressée ornée de papiers pliés propre
au culte Shinto et sensée éloigner les esprits maléfiques.
La plus ancienne
religion du Japon, le Shintoïsme ou "voie des dieux" est en fait un ensemble
de croyances. Le terme de Shinto apparut
pour différencier la religion originelle japonaise du Bouddhisme
(apparu au VIème siècle). Les rapports et influences entre ces 2 religions
sont très étroits. Toutefois, dans le Shintoïsme
national, l'Empereur - ou Teno en est le
Gardien Suprême.
Reposant
sur de vastes concepts d'harmonies qui régissent la nature et les rapports
humains, le Shintoïsme est un animisme. Il vénère les esprits (Kami)
qui sont les supports constants de cette croyance. On n'en compte pas moins
de 800 myriades, autant dire l'infini: les arbres, l'eau, le vent, les ancêtres
sont des Kami inscrits en place d'honneur,
parmi tous les autres, au panthéon du Shintoïsme.
Ils ont chacun leur territoire, leur fonction. Aussi, les héros de l'histoire
japonaise sont également devenus des Kami
après leur mort, un peu comme les saints catholiques. Il est fréquent, même,
lorsqu'on ouvre une boutique ou que l'on construit un immeuble, de faire appel
à un prêtre Shinto qui vient, en grand
costume, chasser les mauvais esprits de l'endroit.
Le portique vermillon d'un torii
domine la charmante plage de Katsura hama, situé près de Kochi, sur la façade
méridionale de Shikoku.
2)
LA RELIGION BOUDDHISTE
Qu'est-ce
que c'est ?
Le premier portait
de "l'Illuminé", ou de Siddharta Gautama,
autrement dit Bouddha, fut apporté au
Japon par les Coréens, au VIème siècle.
Les Japonais lui donnèrent entre autres noms, celui d'Amida
Butsu. Le Bouddhisme ne cessa
depuis lors de se répandre et d'attirer de nouveaux fidèles, désireux d'acquérir
toutes les vertus terrestres dans l'espoir d'une vie future meilleure.
Bonze en prière dans un temple bouddhique.
Et si les japonais meurent bouddhistes, cela a contribué à renforcer l'image
austère du bonze.
Riche de ses
rites, à même d'émouvoir le peuple par la dignité des cérémonies qui se déroulentdans
les temples, cette religion a donné à la société à la fois un côté brillant,
l'art en étant la transcription la plus visible, et un côté grave, comme le
culte des ancêtres qui a renforcé, si besoin était, les institutions familiales.
Le Bouddhisme
fut imposé au début par le pouvoir qui y voyait, outre une discipline morale,
un moyen d'introduire dans l'archipel la culture chinoise. Avec lui, les Japonais
découvraient donc une foule de notions jusque-là inconnues: le cycle des morts
et des renaissances, l'interdiction morale de se livrer à la luxure, la grâce
promise aux croyants. Toutefois, fidèles à leur vieux tribalisme, ils en rejetèrent
tout ce qui ne s'y accordait point et notamment la spéculation métaphysique,
déjà largement altéré par le relais chinois. Surtout, ils lui appliquèrent
leur fondamentale tendance au sectarisme, au morcellement en chapelles où,
autour d'un maître vénéré, on bénéficie en groupe restreint de l'enseignement
sacré.
Temple
ou Sanctuaire ?
Le
bouddhisme a marqué d'une empreinte profonde toute la civilisation
nationale et, par exemple l'architecture. Si la maison traditionnelle, sur
pilotis, dérive largement du sanctuaire shintoïste
primitif, c'est au bouddhisme qu'elle
doit la discrète harmonie de son espace intérieur - matière et couleurs des
parois, aspect végétal, naturel et comme inachevé de l'ensemble -, l'aménagement
de la pièce d'apparat qui transpose à peine l'oratoire monacal, le symbolisme
enfin déployé dans le jardin.
Religion
et Architecture:
Durement
éprouvée par les tremblements de terre (surtout le dernier en 1923) et les
bombar-dements de la 2ème guerre mon-
diale, Tokyo
n'a pas conservé grand chose de son patrimoine religieux. Contrairement à
ceux de Kyoto, qui sont bien souvent plusieurs
fois centenaires, les temples de la capitale ont presque tous été reconstruits
durant ces 40 dernières années.
Comme partout
au Japon, il faut faire la distinction
entre les temples (bouddhiques) et les sanctuaires où se déroulent les cérémonies
shintoïstes. Les 2 religions ne sont d'ailleurs pas contradictoires et si
l'on naît shintoïste, on meurt toujours bouddhiste. En attendant, un temple
bouddhique est appelé ji ou tera,
tandis que le nom d'un sanctuaire shinto est toujours suivi du mot jinja
ou miya.
Il n'est
pas évident de reconnaître au premier coup d'oeil un temple bouddhique d'un
sanctuaire shinto. La plupart du temps, seul les distingue la présence ou
l'absence d'un torii, un portique de bois
qui marquel'entrée des seuls sanctuaires. Il a la forme d'un immense perchoir
d'où le coq du village est censé appeler Amateratsu,
la Déesse du Soleil. De même, si l'on aperçoit au-dessus de la porte d'entrée,
une cordelette de paille tressée (Shime),
on peut être sûr qu'il s'agit d'un sanctuaire shinto et non d'un temple. Cette
corde est la "barrière" qui éloigne les mauvais esprits. Une clochette ou
un gong sont à la disposition des fidèles qui veulent appeler une divinité.
Purification
à l'entrée d'un sanctuaire.